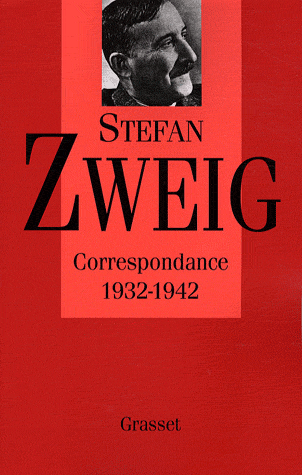On connaît Stefan Zweig, ses romans, ses biographies. Ses oeuvres disent la finesse de ses analyses et sa prodigieuse culture. Cette correspondance des dix dernières années de sa vie dévoile l’homme et amplifie l’admiration que l’on pouvait avoir pour l’écrivain. Pas un détail médiocre, une bassesse ou une trace de narcissisme comme l’on en trouve souvent dans les correspondances à des familiers – celle de Thomas Mann, par exemple, qui est un des destinataires célèbres de ce recueil, avec Romain Rolland, Freud, Joseph Roth, Max Brod, Richard Strauss, toute l’intelligentsia européenne de l’avant-guerre. « Le destin m’a puni d’un regard incorruptible, d’un regard dur et d’un coeur tendre. » En ces années trente, les premières vexations antisémites, l’autodafé de ses livres à Berlin, la fouille de sa maison à Salzbourg qui provoque le début de son errance en Europe et dans les Amériques, tout cela l’atteint au vif de son être. Bien plus, l’horreur inhumaine du nazisme qu’il perçoit très tôt avec une sensibilité de visionnaire et une pénétration politique rare (il prévoit même Pearl Harbour), les malheurs qui s’abattent sur son entourage le transpercent. Il prodigue son temps, son argent, son influence pour soulager les détresses. Il se réfugie à Londres, à New York, au Brésil enfin où il se suicide en 1942. Ce témoignage exceptionnel (tant sur l’Histoire que sur l’histoire littéraire) aurait mérité une préface plus dense et des notes plus circonstanciées.
M. W. et A-M. D.