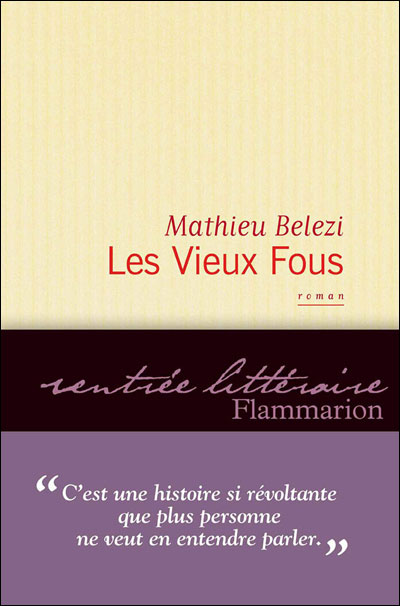À l’heure des soubresauts sanglants de l’indépendance, Albert Vandel, le plus gros colon d’Algérie, entouré de quelques-uns de ses semblables avec lesquels il contrôlait le pays pour ou contre la métropole, voit son monde s’effondrer. Il attend l’apocalypse dans sa maison-forteresse de la Mitidja. Là, il déroule une fresque historique hallucinée où il s’imagine revivre les étapes d’une colonisation ambiguë depuis 1830. Il assume tout : conquêtes, massacres, prédations, racisme, frénésie du profit, sur fond de bonne conscience civilisatrice, jusqu’à l’implacable retour des choses, car « il est trop tard ».
Mathieu Belezi stigmatisait déjà l’aveuglement des grands colons d’Algérie dans C’était notre terre (NB août-septembre 2008). Il fait ici le procès sans nuances de l’ordre colonial. On peut souscrire en partie à son analyse, justifiée par l’histoire, en regrettant que le destin de la masse des « petits » pieds-noirs en soit absent. Écrit dans une langue verte et percutante, ce roman aurait pu être élagué de certaines péripéties souvent répétitives, y compris les prouesses sexuelles obsessionnelles du héros. Il aurait aussi mérité une construction moins alambiquée et plus ramassée.