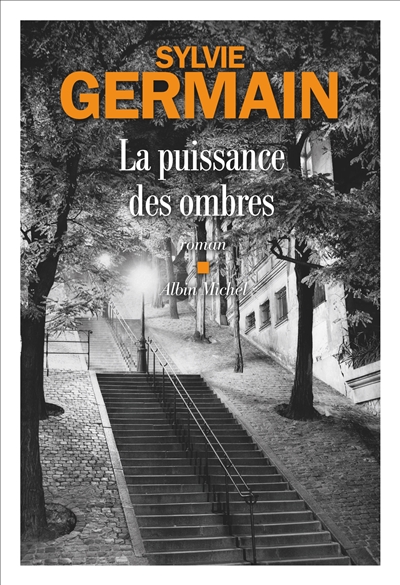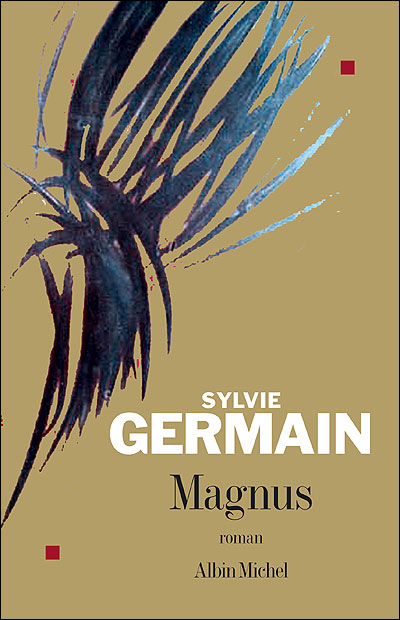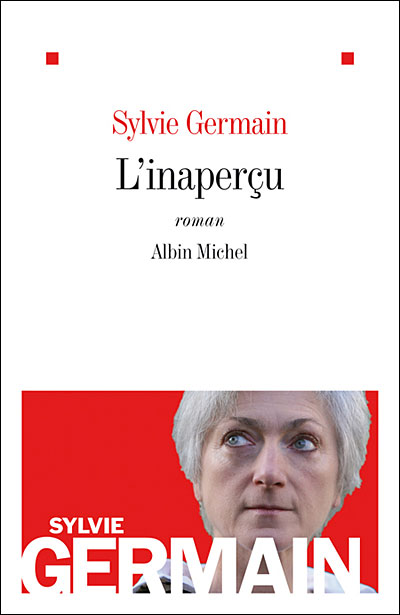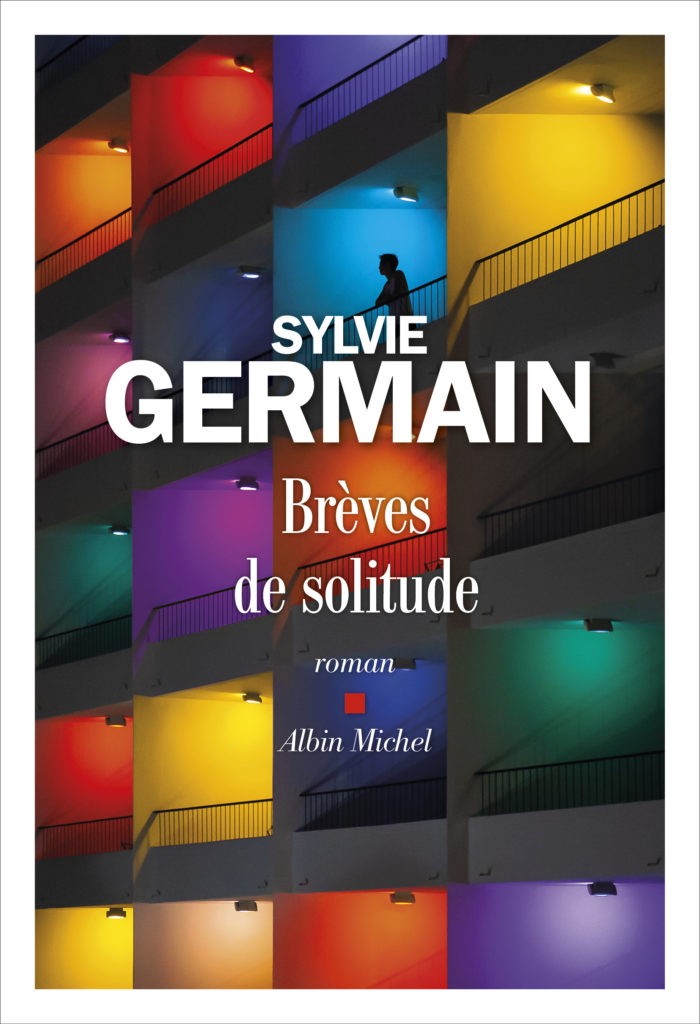L’être humain à l’épreuve du mal
À travers son personnage principal hanté par l’idée de la mort, ce dernier roman de Sylvie Germain porte un regard critique, mais aussi plein d’empathie, sur la misère de la condition humaine et de l’homme sans Dieu. Une écriture poétique, allégorique, métaphorique, accompagne cette réflexion sur les tréfonds de l’âme.
Née à Châteauroux en 1954, Sylvie Germain est une figure littéraire incontournable, pas seulement grâce à de nombreux prix littéraires – entre autres le prix Femina 1989 pour Jours de colère et le Goncourt des lycéens 2005 pour Magnus. Philosophe de formation et passionnée par la métaphysique, elle alterne essais et romans, les premiers éclairant souvent les seconds. On la range volontiers parmi les écrivains mystiques, notamment en raison de son questionnement quasi obsessionnel sur l’absence/présence de Dieu. Depuis les années 1990, elle délaisse peu à peu le « réalisme magique » pour se tourner vers le réel. Elle s’intéresse dans ses derniers romans moins aux drames familiaux qui hantaient ses premiers récits qu’aux tragédies intimes d’êtres malmenés par la vie. En 2008, L’inaperçu ouvre la voie de cette nouvelle source d’inspiration dont on trouve une trace dans Brèves de solitude, en 2021. En écho à cette thématique, le protagoniste de La puissance des ombres est un « personnage fripé, froissé de l’intérieur » dont on suit les affres avec effarement.
Le lecteur est invité à revisiter la « condition humaine » et à retrouver des thèmes et des motifs familiers dans le tissage de ce roman si singulier et prenant. L’intrigue ? Deux chutes fatales apparemment accidentelles mais on découvre vite l’identité du meurtrier ; suivront alors ses ruminations et son parcours jusqu’au terme de ce qui n’est ni un policier ni un thriller.
Le mystère de la nature humaine
En exergue l’une des définitions les plus marquantes de la nature de l’homme : pour Pascal, c’est « une chimère », « un monstre », un « chaos » dont il est impossible de « démêler l’embrouillement ». Son mystère est alors abordé sans jamais peser : on est entraîné dans une fête déguisée où chacun se métamorphose en être « hybride », un motif récurrent qui traduit en images sa complexité. Des personnages burlesques et hétéroclites prétendent avec jubilation être « mille démons ». On s’amuse facilement de l’irruption d’individus dont les accoutrements illustrent les noms… de stations de métro ! Ce jeu loufoque sur le monde souterrain devient rapidement un débat aussi décousu que surprenant avec le marquis de Sade qui « force à descendre là où l’on ne veut pas aller, à voir ce que l’on ne veut surtout pas voir », à sonder les tréfonds de l’âme dans ce qu’elle a de plus inquiétant. Un premier écho à la métaphore du titre qui renvoie aux « ombres » portées des corps, ombres parfois légères et sympathiques mais trop souvent bien inquiétantes.
Le mystère du mal
Les ombres sont aussi la représentation allégorique du mal qui sourd en chaque être et qui peut jaillir dans ce que la psychanalyse appelle le « raptus », ce moment où le « démon intérieur, le refoulé explosent » et peuvent pousser à tuer. L’auteure recourt volontiers à l’imagerie des contes et de la mythologie gréco-romaine, pour tenter de cerner « le versant nord de la monstrueuse chimère que nous sommes ». Si la référence au Minotaure est récurrente, le Centaure, lui, en devient carrément obsédant. Le combat contre le mal, quand il devient une lutte intérieure contre une puissance indéfinissable, conduit souvent à la chute. De nombreux personnages se jettent ou sont précipités dans le vide. Le mal collectif, c’est bien sûr la guerre, et plus précisément ici la guerre d’Algérie avec son cortège d’horreurs qui ont abîmé pour toujours ceux qui l’ont vécue.
Extrait
Page 158
« Avez-vous déjà eu envie de tuer quelqu’un ? De tuer pour de vrai », répond Sylvain […]. Il dit cela d’un ton neutre qui déconcerte les convives.
« Ben, en voilà une idée ! s’étonne Simon.
– Une idée à la con, ajoute Gladys. Et puis, ça veut dire quoi tuer pour de vrai, tuer pour de faux ?
– Pour de vrai : passer à l’acte. Croyez-vous que tout le monde peut commettre cet acte ?
– Potentiellement peut-être, mais dans les faits, non, et c’est heureux. […]
– Il y a des pulsions soudaines, on ne sait jamais, personne ne peut affirmer qu’il ne fera jamais ceci ou cela. »
La tragédie intérieure de « ceux qui ne sont rien »
Lors de la fête déguisée, un certain Sylvain Leuseudre officie comme serveur ; il est ravi dans un premier temps d’exister aux yeux des autres même sur le mode burlesque : le couple organisateur l’a affublé d’un chapeau melon comme le bonhomme de la publicité créée dans les années trente pour la marque Dubonnet. Le slogan « Dubo-Dubon-Dubonnet », parfaitement visible dans le métro pendant des décennies, annonce pourtant la moquerie par le jeu homonymique qui accompagne trois personnages stylisés et progressivement noircis. Quand cet homme simple entend les intellectuels disserter avec cynisme sur le crime et les tueurs en série, son sang ne fait qu’un tour. Le lecteur découvre un être en souffrance qui prend progressivement conscience, en écoutant des poèmes et des chansons slamées, qu’il n’est peut-être « rien », qu’il n’a même pas de « contour, seulement du vide sans cadre ». C’est l’effondrement et la terrible expérience de son inexistence aux yeux de la société, expérience qui le rapproche de certains personnages des Brèves de solitude ou de L’inaperçu.
Un regard critique sur le monde et l’humanité
La romancière n’est assurément pas une auteure engagée mais elle porte un regard volontiers ironique sur le monde dont un des personnages au grand cœur, « irrésigné au chaos » et « à l’injustice repue d’impunité », souligne « l’interminable course de relais menée par la violence, la haine et la bêtise ». Plus que tout, c’est l’absence d’humilité et de bonté qui l’afflige. Dans Brèves de solitude, elle évoquait déjà « l’ordinaire compétition de la bêtise et de la mesquinerie ».
Les arts pour réenchanter le monde
Lors des funérailles d’une des victimes, la danse, la musique et la poésie sont convoquées pour rendre hommage au défunt. Ces arts réunis « enchantent » paradoxalement le meurtrier et le conduisent à une prise de conscience aussi douloureuse que salutaire. Les arts donnent subtilement à un être en profonde détresse quelques clés pour tenter de dénouer « des nœuds de silence » qui l’étouffent depuis trop longtemps. Le protagoniste, qui a vécu presque sans mots ou du moins sans mots justes et vrais, découvre que « seuls les mots des poèmes et des chansons parviennent à réenchanter un peu la vie ». La fin sublime du roman illustre à merveille cette transfiguration.
Une écriture incantatoire
Si les mots sont parfois des « tiques », ils sont avant tout la base d’une écriture poétique qui jongle volontiers avec les néologismes, les gradations et les énumérations pour rendre les mille nuances du réel et en traduire les vibrations. L’écriture part d’images, de métaphores filées à loisir comme « la chimère à métamorphoses » qui surgit çà et là. Moins foisonnante et plus épurée, elle n’a rien perdu de son intensité et de son pouvoir de suggestion. Rien d’étonnant si Verlaine et la poétesse Marie Noël y ajoutent leurs voix.
Sylvie Germain signe dans La puissance des ombres un texte puissant, inspiré, porté par un regard empathique sur un être blessé par la vie auquel elle tente de redonner une forme d’humanité et de dignité, alors même qu’il semble vaincu par la « chimère ». Un roman intense qui donne à réfléchir sur la dérisoire comédie humaine et sur la « misère de l’homme sans Dieu » pour reprendre la célèbre formule pascalienne. Cependant, à la puissance des ombres répond malgré tout et toujours la puissance de l’art.
Annie Karnik, lectrice du comité Adultes
Juin 2022
Sylvie Germain, La puissance des ombres. Albin Michel, 2022.