En 2012, en Suisse, vingt-deux écoliers belges sont tués dans un accident de car. Ni le chauffeur ni la route ne sont responsables. L’accident n’a ni cause ni coupable. C’est un fatal enchaînement de faits et de hasard. Face à la mort d’enfants, à l’immensité de la souffrance, il n’y a pas d’explication, pas de mots pour comprendre, admettre ou simplement évacuer. Le narrateur en est obsédé. Que dire à ceux qui restent ? La parole, la logique, la raison se dérobant, il explore les recours qu’offrent la pensée, l’expérience et la religion pour cerner cet absolu du mal, cet indicible de la mort inexpliquée et arracher du sens à ce drame aveugle, obstinément muet. Pour cela, point d’exercice théorique, mais un récit. L’auteur, jeune écrivain genevois, journaliste au Monde des religions, choisit de faire partager une quête sensible qui le mène, à travers des rencontres et des discussions, imaginaires ou non, d’un mélange de réflexions et de relectures des philosophies – du langage, de l’absurde, du stoïcisme – ou des évangiles, à une interprétation peu orthodoxe du Christ et de l’espérance. Un parcours dense, obstiné mais dépourvu d’insistance. Accessible autant que profond.
Ce qu’il reste des mots
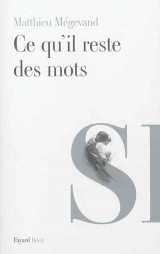
MÉGEVAND Matthieu
