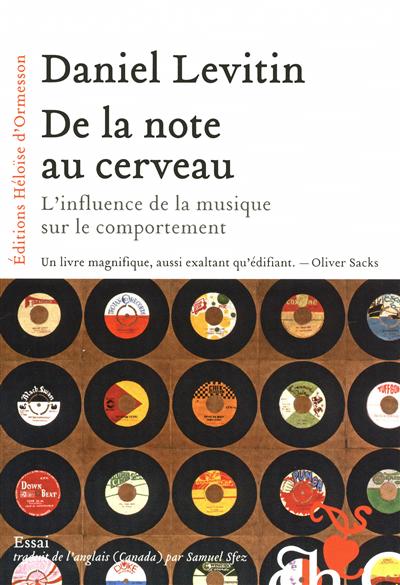Pourquoi ne pas traiter de la musique du point de vue des neurosciences cognitives ? La psychologie expérimentale, les nouvelles technologies d’imagerie cérébrale, la manipulation chimique des neurotransmetteurs, la modélisation des réseaux neuronaux grâce à l’informatique permettent de mieux comprendre ce qu’est la musique, d’où elle vient, comment elle interfère dans nos émotions, nos souvenirs, nos façons de communiquer. En examinant ce que la musique nous apprend sur le cerveau, ce que le cerveau nous apprend sur la musique, nous approfondissons ce que nous savons sur nous-mêmes.
Daniel Levitin, neuroscientifique de réputation mondiale, fut musicien de rock dans les années 1970, s’orienta vers la recherche et devint directeur d’un laboratoire spécialisé dans les relations entre la musique et l’évolution. Son livre, brillant mais technique est d’abord difficile. L’originalité et la fécondité de sa démarche soutiennent l’intérêt. De nombreuses anecdotes éclairent les objets et les résultats des expérimentations qu’il décrit. Les débats théoriques sont présentés de manière concrète et parfois stimulante. Mais la qualité d’ensemble de l’ouvrage souffre d’une composition maladroite, d’une tendance incontrôlée à la digression, d’une focalisation excessive sur le microcosme, certes abondant, créatif et d’avant-garde, des groupes de musique contemporaine et des laboratoires scientifiques californiens.