Lugdunum, en 64. Soucieux de préserver la culture et la langue gauloises de l’envahissement du latin, un druide écrit des chroniques sur des tablettes et les cache dans la colline. En 1777, elles sont retrouvées par un négociant en tissus qui les confie pour traduction à son gendre Antoine Fabert, avocat. Celui-ci découvre que les Gaulois n’étaient pas des barbares, idée qui déplaît fortement aux autorités : un mandat d’arrêt est lancé contre lui. Or il est engagé dans des procès et, avec une comédienne de Paris, doit écrire et monter une pièce qui s’appellera La part de l’aube. D’autre part, un tisserand s’efforce d’utiliser des araignées pour produire une soie étonnante. Enfin, on assiste à la naissance de la première gazette de Lyon. Ce roman historique captive par ses nombreuses connaissances sur l’écriture des Gaulois, et par la topographie de la ville de Lyon, sur lesquelles l’auteur est fortement documenté. Mais comme dans son roman précédent (Le soleil sous la soie, NB novembre 2011), Éric Marchal s’éparpille et peine à fixer l’attention sur des personnages très nombreux et dont les aventures individuelles sont parfois bien banales. Le style est recherché avec des mots étranges, parfois inventés. Les courts chapitres impriment un rythme saccadé. Et c’est beaucoup trop long !
La part de l’aube
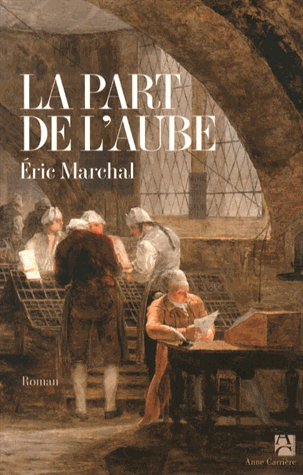
MARCHAL Éric
