La guerre, de l’autre côté. Du côté de ceux qui la subissent, du côté de l’écrivain qui a choisi la littérature pour en témoigner car « il faut parler. Même en temps de guerre. Surtout en temps de guerre. »
La littérature de guerre a fait du chemin ! La Cité grecque confortait sa cohésion en forgeant dans l’imaginaire collectif les grandes figures de l’héroïsme guerrier : L’Iliade chante le mythe dans l’épopée magnifique qui transcende la réalité. Autre chose est le roman, témoin de l’Histoire et d’une transformation de nos regards. Le combattant valeureux de Waterloo a son heure de gloire au XIXème siècle. Puis vient le soldat ordinaire, incertain de son rôle et, de toutes façons, voué au carnage et à la boue des champs de bataille de Barbusse ou de Remarque, pour un hypothétique « Au revoir là-haut ». La compassion et la révolte supplantent la dévotion et l’hommage comme si la certitude qu’il est de « bonnes » guerres, de « justes » guerres se dissolvait dans « l’abattoir international de la folie » décrit par Céline. Dernière mutation : les héros du roman sont choisis parmi les victimes. Au-delà des arguments conjoncturels qui justifient la barbarie réinstallée, il s’agit alors de « dire le désarroi d’un monde dont on ne connaît plus le sens ». Le roman de guerre, s’il n’est militant ou tout en l’étant, exprime, alors, de manière frontale, sa parenté avec la philosophie de l’absurde. L’Internat de Serhiy Jadan est de cette veine.

Serhiy Jadan est un des écrivains les plus populaires de l’Ukraine post-soviétique, récompensé par plusieurs prix littéraires dont celui de la Foire du Livre de Leipzig pour L’Internat en 2018. Sa pensée politique a été honorée en 2022 par le Prix de la paix des libraires allemands (annexe) et le prix Hannh Arendt. Après La route du Dombass en 2010, il a publié L’internat en 2017. Au cœur de ces deux romans, un territoire que l’actuel conflit en Ukraine nous a appris à situer sur une carte. Ironie de la construction des savoirs !
L’Internat raconte l’étrange guerre qui a opposé, là, soldats ukrainiens et séparatistes pro-russes sur un territoire transformé en un incertain champ de bataille. Pacha, un des deux protagonistes, quitte la maison pour aller chercher son neveu de 13 ans, à l’internat à l’autre bout de la ville. Un interminable périple commence alors, dans la neige mouillée, trois jours de cauchemar, au terme desquels le gamin est ramené chez lui sain et sauf.
Le territoire
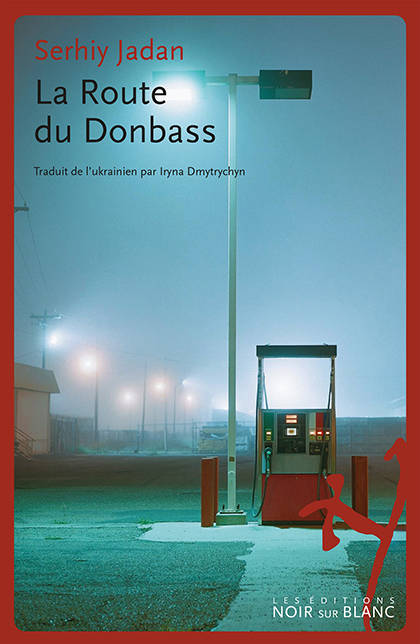
La carte ou le territoire ? Le choix de tel ou tel mot a un sens. Le roman de Serhiy Jadan parle d’un territoire, d’une terre réelle et non de sa représentation, d’un territoire, au plus près de la perception qu’en ont ses personnages ; un territoire aux cartes illisibles, à la géographie bouleversée, noyé de surcroît dans les brumes de l’hiver, quand « le brouillard est descendu sur la route comme du lait chaud échappé d’une casserole» (p.92) et que la limite entre ville et campagne s’est dissoute dans le chaos du moment. C’est, sans aucun doute, à cette terre en souffrance que s’arrime, dans l’émotion et la métonymie, l’identité de l’écrivain :
« Cet hiver, les arbres sont particuliers. Ils sont sensibles comme les animaux, frémissent à chaque explosion, gardent leur chaleur à l’intérieur, ne gèlent pas ; le sol fond autour de leur tronc, laissant apparaître dans les ronds noirs la vieille herbe verdâtre. L’écorce est humide et vulnérable, lorsqu’on la touche, on se tâche de ce jus de douleur sombre, comme de la peinture, comme le sang des entrailles. » (p.42)
«Même les pigeons ne traînent pas. Où sont-ils d’ailleurs ? Pacha (…) les aperçoit soudain, des centaines de boules de plumes serrées comme des poings, des centaines de becs qui pointent sur lui d’en haut, des centaines d’yeux ronds, figés d’un effroi constant, des pigeons agglutinés les uns contre les autres, se poussant l’un l’autre comme s’ils avaient froid, bien qu’en réalité ils n’aient pas tant froid que peur » (p.49)
La maison, l’internat et la gare : les trois piliers du territoire
La maison donne au périple de Pacha son double point d’ancrage « du matin de janvier… long et immobile, comme une file d’attente dans un hôpital » (p.13) à ce dernier jour, à cette dernière phrase si riche de sens : « La maison sent les draps propres » (p.267). Elle est le dernier endroit où se terrer, à l’abri des nouvelles du dehors et de la désintégration des liens d’appartenance dynamités par la guerre. Tant qu’elle n’a pas elle-même, comme dirait Céline « attrapé la guerre » comme d’autres la peste. Car alors
» tous ces biens perdent immédiatement leur valeur, empestent la misère et le dénuement, et la vaisselle luit dans la lumière des phares de sa graisse non lavée, et les meubles ressemblent à des carcasses, déterrées de la terre humide de janvier. » (p.242)
L’internat, à mi-chemin du récit, bénéficie d’un traitement plus original : au cœur de nulle part, il protège les enfants de la folie des hommes et Nina qui en a la charge y maintient une discipline de vie, chacun jouant son rôle, pour leur apprendre l’essentiel : résister à l’indignité de la peur qui vérole les adultes. Quelle leçon !
La gare est le troisième édifice émergeant symboliquement de la neige, ouvert, lui, aux quatre vents, quartier général fébrilement inorganisé et cour des miracles, vers où mène, sans destination envisagée, cette débandade humaine déboussolée, dans l’espace de la guerre, dans le temps de la guerre.
Autour de ces trois repères, s’ouvre ainsi dans l’espace romanesque un double itinéraire : celui de tous les errants qui ne mène nulle part et celui des deux protagonistes en quête d’une route à suivre pour que l’errance devienne voyage…
Les « natifs » du territoire
Ainsi sont identifiés les protagonistes du roman, des « natifs » plutôt que des civils comme pour renvoyer à une légitimité plus forte, celle du sol où ils sont nés. Tous ceux que la guerre a jetés hors de leur maison et qui errent tels ces chiens abandonnés que le romancier dote d’un sixième sens « comme s’ils savaient que rien ne peut être pire, que rien ne sera pire, et que, de manière générale, il n’y aura plus rien. » (p.100)
Les « natifs » sont la matière de « ce grouillement humain empesté et effrayé » (p.51) cette cohorte d’hommes, de femmes et d’enfants hébétés, qui, à aucun moment n’ont pris parti, qui fuient en vain la peur, sans savoir où aller, dans des scènes hallucinées, cauchemardesques comme celle où une femme hurle « On m’a pris mon or. » (p.52) Ce sont eux qui incarnent cette guerre dans son absurdité première ! Pacha est l’un d’eux, lui « qui n’était pour personne », au temps proche des élections, un prof. un fonctionnaire donc, transparent, insignifiant jusqu’à cette épreuve de trois jours au cours desquels le romancier fait de lui un homme. La guerre aurait-elle cette vertu ? Sans doute fallait-il, dans cette peinture d’une humanité dénaturée, le fil conducteur d’un espoir : le dénouement heureux de cette traversée de l’enfer. Plus profondément, le roman de guerre se double d’un récit d’apprentissage : trois jours d’épreuves, celles d’un voyage initiatique où les vertus héroïques de courage, de solidarité, soudent progressivement l’adulte et l’adolescent contre la peur. Comme pour ponctuer l’apprentissage du plus jeune par son aîné, c’est à lui que le romancier confie la narration des dernières pages et le mot de la fin. Le relais est assuré.
Les marqueurs du territoire
L’issue de la guerre est-elle entre les mains des combattants ? Puissance troublante de ce texte : ils ne sont que rarement identifiables ; dans le forum improvisé que devient la gare, bien malin qui reconnaît « les vôtres », tant les drapeaux sont déchirés, le matériel, d’appartenance incertaine et l’intonation russo-ukrainienne des voix, semeuse de doute. C’est à un journaliste étranger, Peter, que Serhiy Jadan confie la mission d’observateur cynique de ce bourbier. C’est lui qui ébauche à l’intention de Pacha un fondement à la revendication du territoire par les uns et par les autres :
« Enseigner l’histoire dans votre pays c’est comme pêcher du poisson, on ne sait jamais ce qui va ressortir. (…) Je vous conseillerai seulement d’être prudent avec l’histoire. L’histoire, voyez-vous, est une chose… une chose que personne n’a le droit de vous prendre. » (p.31)
Ironie dramatique : des militaires sont entrés, qui ont fait taire cette péroraison. Mais l’argument des armes n’est qu’un démenti pitoyablement circonstancié à cet embryon de réflexion. Le romancier, subtilement, conduit le lecteur sur une autre voie, celle du cœur, du sentiment enraciné d’appartenance à cette terre : « Nous avions un vrai pays, nous n’avions pas besoin d’avoir peur. » (p.126) Nina qu’on entend ici s’adressant, elle aussi, à Pacha, exprime sans doute la position de Serhiy Jadan en pointant du doigt la responsabilité de chacun. . Sa propre lecture du conflit irrigue le roman et justifie le choix de narrateurs subjectifs : Il dénonce avec énergie, dans cet affrontement, la responsabilité de tous les Pachas pusillanimes
« Comme si cela ne vous concernait pas. Alors que cela fait longtemps qu’il fallait prendre position et décider de quel côté vous êtes. Mais vous vous êtes habitué à vous cacher toute votre vie.(…) Bref tout le monde devra répondre. Et ce sont ceux qui n’ont pas l’habitude de répondre qui connaîtront le pire. » (p.129)
La littérature, territoire de l’engagement
Le roman de guerre peut-il ne pas être roman engagé quand son écriture est contemporaine des événements dont il parle ? L’Internat l’est évidemment dans l’analyse fine qui sous-tend l’intrigue. Qu’est-ce qui fait que ce territoire est mien ? Il faut lire, dans son intégralité, le discours prononcé par Serhiy Jadan lors de sa réception du prix de la Paix des libraires allemands (en annexe) pour comprendre. Une des plus belles pages jamais écrites pour la défense de la langue. Le romancier parle de la langue, celle dans laquelle il écrit, celle que la guerre brouille comme on brouille des signaux-radio. Sans doute, là aussi, le choix s’impose : russe ou ukrainienne la langue est un marqueur fort de l’identité, mise à mal par la guerre, enjeu de la guerre et blessure intime de celui qui écrit. Le roman ne cesse, au fil des pages, de le rappeler : un homme « à la gueule vulpine (…) parle russe avec un accent étranger, comme s’il avait entendu cette langue uniquement à la télé » (p.64). Plus loin, à l’orphelinat, tout est dit de ce métissage politique de la langue : « un sabir administratif » dans lequel « les généraux à la retraite relatent à leurs petits-enfants les pages héroïques de leur biographie » (p.122). Ironie dramatique : dans un passé tout proche et en même temps si lointain, Pacha enseignait « la langue » ! Plus noire encore, l’ultime allusion à la parole vient de la sonnerie des portables à laquelle, dans la neige, on repère un mort encore lié au monde par ce marqueur incongru et macabre, en ce lieu, de la communication des temps modernes.
La littérature, territoire de l’indicible
Serhiy Jadan est chanteur, poète et romancier et, à ce titre, la langue est son territoire. Il vit en Ukraine, à Kharkiv, tout près de la frontière russe, la réalité quotidienne de la guerre. Comment en parler ? comment en garder trace pour ceux qui ne l’auront pas vécue ou qui l’auront oubliée ? Quelle langue inventer pour dire l’inédit, l’horreur au quotidien ? L’indicible de la dégradation de l’homme démoli par la peur, comment le dire sans jugement facile et injuste ? L’internat est sa réponse : la fiction éclaire la réalité, la langue précise, pittoresque, sensible, invente une poétique de l’horreur, une manière de dire cet autre côté de la guerre. Avec un lyrisme comparable à celui du discours d’Albert Camus à Stockholm en 1957, Il consacre à cette question essentielle du devoir de l’écrivain et de la question de l’écriture une part importante de son discours de réception du Prix de la Paix des libraires allemands en 2022. Écoutons-le :
« Comment parler de la guerre ? Comment maîtriser les intonations qui recèlent tant de désespoir, de colère, de ressentiment, et en même temps de force et de détermination de ne pas abandonner les siens, de ne pas reculer ? Il me semble que le problème de l’expression de ce qui est le plus important n’est pas seulement en nous. Le monde qui nous écoute est tout aussi incapable de comprendre une chose simple : nous nous exprimons en nous appuyant sur un niveau trop différent d’émotion linguistique, de tension linguistique, d’ouverture linguistique. Les Ukrainiens ne doivent pas se justifier pour leurs émotions, mais il serait bon de les expliquer. Pour quoi faire ? Ne serait-ce que pour ne pas contenir toute cette douleur et toute cette haine. Nous réussirons à nous présenter, nous saurons nous expliquer, parler de tout ce qui nous est arrivé et de ce qui nous attend encore. Il faut juste être prêt au fait que cette conversation ne sera pas facile. Cependant, d’une manière ou d’une autre, il faut la commencer dès aujourd’hui. »
Lire le discours de l’auteur lors de la réception du Prix de la Paix des Libraires allemands en suivant ce lien Prix-de-la-paix-des-libraires-allemands-2022-pour-serhiy-jadan-discours-de-reception-du-prix/
Claudine Bergeron,
lectrice du comité Hors Champ.

