Un grand texte, puissant, angoissant, inoubliable
Dans une des chroniques littéraires rassemblées dans Le Cycliste du lundi (recueil posthume, La Grande Ourse, 2012), François Nourissier écrivait :
« Puis vint l’automne 1967 et l’on découvrit un vrai roman de Catherine Guérard, composé il est vrai d’une seule phrase, mais une phrase longue de cent quatre-vingt-quinze pages. Cette phrase frôla le Goncourt, aventure qui prouve que nous pouvons tout attendre de cette romancière. […] Catherine Guérard a écrit un roman qui défie l’imitation et décourage la comparaison […] je ne sais pas ce qu’elle écrira ensuite, ni quand, ni même si elle n’attendra pas encore une dizaine d’années avant de se remettre au travail ; il n’en est pas moins sûr que nous avons affaire avec Catherine Guérard à un personnage exceptionnel ; Renata n’importe quoi suffirait à nous empêcher d’oublier son auteur. »
En dépit des attentes de François Nourissier, Renata n’importe quoi (Gallimard, 1967) restera le dernier roman de Catherine Guérard (1929—2010), disparue mystérieusement et brutalement des radars de l’Édition dans les années 70 et suivantes.
Fin 2021, Jérôme Garcin salue la première réédition de Renata n’importe quoi aux Éditions du Chemin de Fer :
« Strident comme un cri dans la nuit, poignant comme un adieu, ce monologue intérieur et itinérant, dont la révolte sociale emprunte au théâtre de Genet, semble destiné à la scène. Il est tellement prémonitoire. Merci aux Éditions du Chemin de fer de nous apprendre que Catherine Guérard nous manquait. »
L’Obs, 22 novembre 2021
« , Il y a des portes, les portes, c’est fait pour partir, j’ai dit, »
Renata n’importe quoi, c’est le soliloque ininterrompu d’une femme simple qui en a assez et qui part pour être « une libre », libre de choisir son prénom, son nom, de ne plus obéir à rien ni à personne, jamais. Pendant trois jours et deux nuits, elle déambule dans Paris, de banc public en banc public, avec pour tout bagage quatre malheureux cartons ficelés à la va-vite sur lesquels elle veille comme sur le plus précieux des trésors.
C’est d’abord l’ivresse joyeuse de planter là sa patronne, la concierge de l’immeuble, les commerçants de sa rue, qui ne comprennent pas ce qui lui prend tout à coup. Puis, ses étonnements comiques (un self, le métro, un hôtel minable), ses bonheurs touchants (une rose, une pomme, le petit jour, le chant des oiseaux). Plus tard, sa rage et sa révolte, quand des personnes qu’on dit bien intentionnées tentent de mettre un terme à son envol, en la réinsérant malgré elle.
Alors oui, Catherine Guérard choque avec une ponctuation réduite au strict minimum (la virgule) pour rendre à l’écrit le flot des pensées de son héroïne. La virgule pour la respiration, le souffle. Après tout quand on se parle à soi-même on ne met pas les points au bout des phrases, ni deux points, ni points virgules, pas de points d’interrogation ni d’exclamation non plus. Mais il y a des majuscules qui structurent les ruminations de Renata, lorsque son attention est attirée par quelque chose ou quelqu’un, ou qu’elle se rapporte à elle-même les (rares) propos qu’on lui a adressés.
Après une courte adaptation on pige vite le truc, le rythme. On se glisse dans le phrasé inimitable de Renata, on sourit de ses formules dont la fantaisie révèle la clairvoyance, on partage ses indignations naïves et ses refus de se plier à des dictats imbéciles.
« , Bien, elle a dit, avez-vous une pièce d’identité ou une quittance de loyer, et moi j’ai dit Oui, et j’ai cherché mon vieux portefeuille dans mon sac et j’ai pris dedans ma carte d’identité et je l’ai donnée à la bonne femme mais je n’étais pas contente, ça ne la regardait pas mon âge et mon nom et tout ça cette bonne femme, et elle l’a regardée et tout de suite elle a dit Mais elle n’est plus valable votre carte, alors moi j’ai été en colère Pourquoi, j’ai dit, Mais parce qu’il y a vingt-cinq ans qu’elle a été faite, elle a dit, Et alors j’ai crié, moi c’est moi, il y a vingt-cinq ans c’était moi aussi, Je regrette, elle a dit en me tendant la carte, je ne peux pas vous ouvrir un compte avec ça, C’est la loi des banques, j’ai demandé, C’est le règlement elle a dit, Tous des saletés alors ces règlements, j’ai dit, et puis j’ai repris mes paquets et je suis partie vers la porte mais la bonne femme m’a rappelée Vous oubliez votre carte, elle a crié, mais ça m’était bien égal, à quoi elle me servait cette carte, une indiscrétion qui disait mon âge et tous les secrets sur moi, alors je suis sortie de la banque sans retourner la prendre, ma carte, et dans la rue j’étais bien contente que plus personne puisse savoir comment je m’appelais, si on me demandait je dirais que je m’appelais n’importe quoi, Renata Mésange, Renata Fougère, et puis voilà ils ne sauraient jamais la vérité, personne, et c’était encore plus la liberté qu’avant, ça, et j’étais toute heureuse, »
p. 124-125
C’est un roman étrange, d’une originalité radicale et moderne, marquante. C’est une chimère littéraire qui engage émotionnellement le lecteur. Renata fait ce qu’on aimerait pouvoir faire quelquefois, à savoir tout envoyer promener, mais elle n’a, contrairement à nous, aucun scrupule, aucune retenue, aucune réticence à abandonner pour toujours travail, logis, confort. Renata décide du jour au lendemain de se libérer de toute contrainte, de rejeter tout projet, toute anticipation.
Ce roman est un défouloir : Renata se défoule, Catherine Guérard se défoule, le lecteur se défoule !
Le temps du roman, on veut être Renata, on l’envie, on l’aime pour sa liberté sauvage, et en même temps on sait que c’est une utopie, qu’on ne peut pas être Renata ; on lui en veut un peu (ou beaucoup) pour ça. On est parfois pris entre empathie et irritation, on se surprend à se moquer d’elle avec ceux qu’elle traite de « nouillards », puis on regrette parce qu’on a de plus en plus confusément peur pour elle, peur pour nous.
Une douce folie
On n’oubliera pas Renata. On ne pourra pas. Contre tout principe de narration et de construction d’un personnage romanesque, Catherine Guérard ne dit rien de son passé, rien bien sûr de son état-civil. Lorsqu’on interroge Renata, elle ment effrontément et se remémore ensuite en rigolant les bons tours qu’elle a joués. Sa pensée sans repos la définit toute entière dans l’instant, à chaque instant. D’abord pimpante, effroyablement candide, et peu à peu de plus en plus tragique à nos yeux.
Un peu débile peut-être, mais pas complètement, ou alors c’est par feinte, par alibi, par prudence. Sans filtre et imprévisible, en équilibre entre autisme léger et clairvoyance fulgurante. Seul lien à son histoire personnelle, le paquet de lettres qu’elle protège des intempéries et trimballe partout avec elle. Les lettres de Paul…
« , et je voyais des fenêtres allumées dans la maison d’en face et j’ai pensé Est-ce qu’il y a des femmes heureuses qui habitent là, est-ce que ça existe d’être heureux quand on n’est pas libre, j’ai pensé, Non, j’ai pensé, on n’est pas heureux quand on rentre dans la même maison tous les jours, et longtemps j’ai regardé les fenêtres allumées, et je pensais que moi je n’avais jamais été heureuse, alors j’ai pensé à Paul, et puis j’ai encore regardé la maison aux lumières et j’ai pensé Si je mettais le feu à la maison, tout brûlerait, et comme ça les gens seraient libres puisqu’ils n’auraient plus de maison, Et avec quoi je mettrais le feu, j’ai pensé, Avec les lettres de Paul, j’ai répondu à ma pensée, alors là j’ai ri, j’étais bien gaie, Brûler les lettres de Paul, j’ai pensé en rouspétant cette bête idée, ça jamais, les lettres de Paul c’est comme mon cœur, et je riais, et j’ai pensé Ça pour une bonne soirée c’est une bonne soirée, et alors j’ai dû faire un peu de bruit à chanter des petits airs parce que tout à coup il y a eu une lumière qui s’est allumée derrière moi, et une dame est sortie de la maison où j’étais assise Et alors, elle a dit, ce n’est pas l’Opéra ici, »
p. 95-96
La reine de la nuit
« , et je suis repartie, comme ça, je ne savais pas où, n’importe où, Toujours pas à l’hôtel, j’ai pensé, payer pour ne pas être libre, ah non, et le petit soir tombait et moi j’aimais quand le petit soir tombait, c’était un beau moment de la journée et j’ai pensé Personne ne connaît comme c’est beau, cette heure, ils sont toujours pressés à cette heure-là, à toutes les heures ils sont pressés, alors j’ai pensé Si les autres n’en profitent pas cette heure elle est à toi, et j’étais si contente que c’était comme si mes yeux riaient de joie, alors j’ai pris une rue plus tranquille et au bout de cette rue le ciel était rose, et il y avait des jolis cris d’oiseaux qui tournoyaient dans le ciel, et alors j’aurais bien voulu m’asseoir pour profiter bien de cette jolie vie, mais il n’y avait pas de bancs, alors j’ai continué des rues vers le ciel rose, et puis maintenant c’était une petite nuit qui tombait et tout est devenu gris et des ombres, et alors j’ai pensé Ceux du métro, et ceux qui dînent, et ceux des cinémas, ils manquent tous cette belle heure, ils manquent toute la beauté, Alors c’est moi la reine de la nuit, j’ai pensé, »
p. 94-95
À la recherche de Catherine Guérard
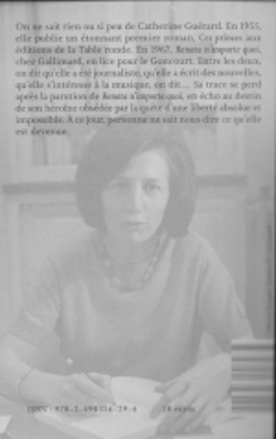
Les éditions du Chemin de Fer ont mis en quatrième de couverture (rabat) une photo de Catherine Guérard en train de dédicacer Renata n’importe quoi (circa 1967).
L’effet de surimpression renforce la tonalité douce, effacée, presque fantomatique du portrait.
Pour cette réédition, François Grosso et Renaud Buénerd se sont mis en quête – difficilement car il reste peu de témoins directs – d’informations sur la personnalité de Catherine et le pourquoi de son effacement.
Ils ont recueilli des données biographiques : son nom de naissance, ses dates de naissance et de décès que son précédent éditeur, Gallimard, ne connaissait plus.
Et des éléments souvent contradictoires, mais des surprises aussi.
Ils ont rencontré Yvonne Baby (née en 1929 comme Catherine).
En 1967, elle est lauréate du prix Interallié, Catherine Guérard manque de peu le Goncourt et le Renaudot. Elles deviennent amies et correspondront longtemps après le départ de Catherine pour Collonges-la-Rouge dans la Corrèze. Elles sont associées dans la création du Prix d’Honneur du roman (prix littéraire éphémère visant alors à secouer l’inertie du Femina) qui couronnera notamment Henry Bauchau (Le Cavalier noir, 1972) et Annie Ernaux (Ce qu’ils disent ou rien, 1977).
Dans À l’encre bleu nuit (Baker Street, 2014) Yvonne Baby écrit de son amie qu’elle était “grave et impertinente, les yeux amusés, romantiques”, qu’elle était lumineuse et étrange ; musicienne ; féministe ; elle se souvient de sa “silhouette frêle et frileuse, le visage et les cheveux fins, un rire rapide qui lave instantanément les médiocrités, les trahisons, imprégné de tout l’humour qu’inspire une profonde mélancolie. Catherine est souvent malade et sourit des souffrances, s’apaise en les racontant.”
Dans son portrait de Catherine Guérard, Yvonne Baby lève le mystère de la dédicace : “Catherine a dédié Renata n’importe quoi à François, qui allait présider la France — François, la constance, [lui] écrira Catherine [à Yvonne Baby] des années après.”
Un petit (ou grand) mystère dévoilé, mais il en reste beaucoup — heureusement !
Toujours d’après Yvonne Baby, peu après 1967, Catherine a une correspondance amoureuse avec Paul Guimard (ami de Mitterrand), second mari de Benoîte Groult : Blandine de Caunes (fille de Benoîte) a retrouvé récemment des lettres de Catherine Guérard à son beau-père.
Tilly Richard, lectrice Hors Champ
Mars 2022

